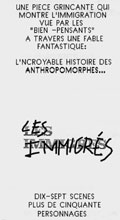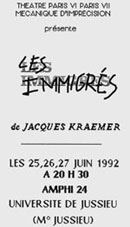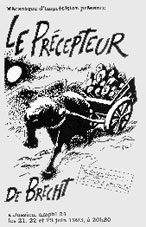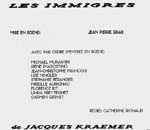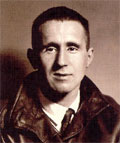|
|
|
Avant-propos
Voici un spectacle sur l'immigration où l'immigration n'est pas jouée au premier degré, mais où est jouée, de façon critique, la vision déformée que les couches de la bourgeoisie ont de l'immigration. Cette vision est grotesque et, dans ce grotesque, s'embusque l'idéologie qu'il s'agit pour nous de piéger à travers ces multiples moyens de pression et caisses de résonnances que sont le mythe du "bon sens populaire", la vision historique de l'Européen civilisé et civilisateur, le cinéma américain et les bandes dessinées de série Z... |
|
|
A propos de Lenz
L’angoisse vécue par Lenz est apparentée, dans son expression, à celle que traduisent l’œuvre de Kierkegaard et, davantage encore, celle de Kafka. Lenz l’analyse lui-même à plusieurs reprises dans des ouvrages pseudo-théologiques qui ont en réalité une fonction psychothérapeutique d’auto-analyse : la fixation persistante du désir sur le personnage maternel, l’ambiguïté des sentiments à l’égard d’un père qui incarne (il est père et pasteur) une instance morale et religieuse reçue à la fois comme légitime et comme répressive, constituent une situation œdipienne qui se résout en une fascination et une terreur du sexe. Le motif central de l’ensemble de l’œuvre, dérivé de la parabole de l’enfant prodigue, repose sur l’impossibilité de satisfaire le désir. Toute activité sexuelle en dehors du mariage tombe sous le coup de l’interdit paternelle, et sa transgression attire sur le coupable un châtiment qu’il finit par assumer lui-même : le précepteur s’émascule après avoir été châtré moralement par les soins de Venceslas, son père adoptif… |
|
|
1992 Les immigrés
Jacques
Kraemer :
Formé rue Blanche et au Conservatoire National à
Paris, Jacques Kraemer, comédien, metteur en scène
et auteur, fonde en 1963 le Théâtre Populaire
de Lorraine.
En 1982, il quitte le T.P.L. et crée sa compagnie.
Jusqu’à sa nomination, en 1993, à la direction
du Théâtre de Chartres, il met en scène
et présente chaque année une nouvelle pièce,
alternant des oeuvres dont il est l’auteur et des oeuvres
classiques ou contemporaines.
A partir de 1993, les créations de la Compagnie coproduites
par le Théâtre de Chartres se poursuivent, à
Chartres, à Paris, au Festival d’Avignon, et
en tournées.
En 2005, il quitte la direction du Théâtre, mais
la Compagnie reste implantée à Chartres et y
poursuit son travail de création avec le diptyque Vinaver
: "Dissident, il va sans dire" et "Nina, c’est
autre chose", "Agatha" de Marguerite Duras
et "Phèdre/ Jouvet/ Delbo". de Jacques Kraemer.
Parallèlement, Jacques Kraemer a enseigné à
l’ENSATT, rue Blanche, à l’Université
de Strasbourg, à l’Institut d’études
théâtrales de Paris III ; il continue à
transmettre l’art théâtral dans les lycées
de l’agglomération chartraine. |
Présentation
:
On a tenté d'éviter un double écueil
:
1) Le naturalisme qui guette tout spectacle qui veut rendre
compte de la réalité sociale. Pour s'en dfendre,
nous avons utilisé plusieurs garde-fous :
-la transposition de l'histoire de l'immigration dans la fable
fantastique des anthropomorphes ;
-le décentrement du sujet qui demeure en coulisse ;
-le jeu très théâtralisé dans le
sens d'un certain "expressionisme comique" ;
-l'emprunt au monde du travail des éléments
de décor et des accessoires créant les univers
de la bourgeoisie.
2) La caricature grossière qui est souvent le lot des
spectacles où le sujet (ici l'immigration) impose une
prise de parti nette et vigoureuse. La conséquence
la plus évidente de la caricature grossière
est le caractère non-dialectique du spectacle avec
comme corollaire l'impossibilité de permettre le travail
du spectateur. Il y a dénonciation , au premier degré,
à laquelle le spectateur adhère ou n'adhère
pas, selon ses propres positions idéologiques ; il
n'y a pas possibilité pour le spectateur, de produire
réflexions et sentiments lui permettant de modifier,
enrichir, affiner sa perception du monde. |
|
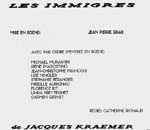 distribution
distribution
|
Composée
de 17 saynettes, la pièce nécessite au minimum
une femme et deux hommes pour représenter tous les
personnages. Mais rien n'interdisait de partager les rôles
entres plusieurs comédiens, ce qui nous a permis de
diversifier le jeu. |
1. Bijou dans la
forêt vierge
2. Trafic et crucifix
3. La croisière des milliardères
4. En famille
5. Au cimetière
6. Le représentant
7. La main dans le sac
8. Le bouc émissaire
9. Réception
10. Welcome aux anthromorphes
11. Marchands de sommeil
12. Dans le château de monsieur le Baron
13. Dans l'épicerie
14. Au café
15. La grande crise
16. Par erreur
17. La fuite |
|
| 7
- La main dans le sac |
17
- La fuite |
La
petite dame : C'est surtout quand tout le monde
dort, par les nuits sans lune, qu'ils font leurs coups.
Il y a quelques mois, on tire les Rois ; je me casse
une dent sur la fève : j'emporte la couronne.
Le soir, je me mets au lit, je pose la couronne sur
ma table de nuit. Le matin : plus de couronne. Vous
vous rendez compte.
Et c'est pas la première fois que je remarque
qu'il y a des choses qui disparaissent dans la maison.
Qui ça peut être ?
Le paysan : Les morphes.
La petite dame : C'est sûr, je vous dis,
c'est sûr.
Le paysan : Il y a quelque chose qui remue dans
votre sac.
La petite dame : Une voisine, c'était
sa brosse à dents ; disparue. La fille de la
voisine : ses boucles d'oreilles.
Le paysan : Chez nous, le pépé,
il ne retrouve plus sa pipe. Ca saute dans votre sac
!
La petite dame : Vous avez fini de vous occuper
de mon sac. Donnez-moi mes oeufs.
Le paysan : Tenez, mettez-les dans votre sac.
La petite dame : Non, ils vont se casser.
Le paysan : Faites voir ce qu'il y a dans votre
sac.
Le paysan essaie de s'emparer du sac par la force.
La petite dame : Ca ne vous regarde pas. Ne me
bousculez pas. Espèce de brute. Je le dirai à
mon mari.
Le paysan : Un chat !
La petite dame : Oui, c'est mon chat, parfaitement.
J'ai bien le droit de l'emmener avec moi. Je ne voudrais
pas qu'un morphe me le chope et le dévore ; ils
en sont très friands.
|
|
| Dans
le parc, le directeur de l'une des fabriques près
de son automobile, un pistolet à la main.
Le Directeur : ...Tout ça s'est mélangé,
infiltré, avec les vagues successives. Ils se
ressemblent tous, comme deux gouttes d'esu. On ne parvient
plus à discerner.
Et s'ils viennent manifester autour de ma demeure, avec
des pancarte, des hurlements, des sifflets, des quolibets,
ils seront tous ensembles, LIGUES.
Alors, c'est horrible, mais moi, ici, JE NE ME SENS
PLUS CHEZ MOI. ET EUX ILS SE SENTENT CHEZ EUX.
Alors dépêche-toi, ferme le coffre, on
file.
Je me sentirai plus en sécurité, à
quelques kilomètres, dans mon autre villa.
Voilà la fille du cafetier qui ressort de chez
elle ! Elle m'espionne ! Où va-t-elle ? Elle
est en chaleur, par moins dix degrés.
La fille : de loin. Salut Antonio.
Le chauffeur : à la fille. Chiao,
Anna.
Le directeur : regardant son chauffeur avec
une défiance horrifiée. Vous en êtes
tous, c'est un complot ! Ne touche pas MA voiture !
Je te chasse.
Comment faire ?
JE NE SAIS PAS FAIRE FONCTIONNER CETTE MACHINE SANS
LUI.
Il monte dans sa voiture et fait signe au chauffeur
de la mettre en marche. |
|
|

Jakob
Michael Reinhold Lenz
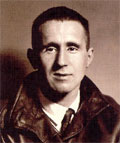
Bertolt Brecht
|
1993 Le Précepteur
Pour
Jakob Lenz et le XVIIIè siècle, le précepteur
Laüffer était un personnage tragique. En 1950,
il ne l'est plus pour Bertolt Brecht. Pour l'adaptateur
du Précepteur, il s'agit avant tout de retrouver
la comédie qui se cache sous la "tragédie
bourgeoise". Là où Lenz raconte avec
une voix qui s'étrangle, Brecht affiche un sang-froid
serein et une ironie critique.
Avec les personnages du précepteur Laüffer,
du maïtre d'école Wenceslas et des étudiants
Bollwerk et Poetus, Lenz portait à la scène
le problème de la pédagogie comme symptôme
de la désolation allemande. Il montrait à
travers un spécimen de chair et de sang l'autocastration
des intellectuels, qui à son époque étaient
plus ou moins contraints d'exercer le métier de précepteur.
"De
cette manière, les personnages de cette pièce
ne sont pas non plus ni sérieux, ni comiques, mais
tantôt sérieux, tantôt comiques. Et le
précepteur récolte notre compassion, étant
donné qu'il est fort opprimé, et notre mépris,
étant donné qu'il se laisse si fort opprimer"
écrit Brecht dans ses notes sur le "Précepteur"
(Ecrits sur le théâtre).
Extraits
du programme distribué à la Faculté
de Jussieu |
|

Distribution
lors des représentations des
21, 22 et 23 juin 1993
Remerciements
à Natalie Ambert pour les choix musicaux, Pierre Viguié
pour l'affiche et Solange Münzer pour la plaquette.
«La comédie est une peinture de la société
humaine et, quand celle-ci est empreinte de gravité, la
peinture ne saurait susciter le rire.»
[ Jakob Lenz ]
|
Jakob
Michael Reinhold Lenz 1751-1792
|
Bertolt
Brecht 1898-1956 |
Lenz est avec Gœthe et Klinger l’un
des fondateurs du mouvement "Sturm und Drang" (Tempête
et passion), mais le seul dont la révolte durera jusqu’à
sa mort. Surtout connu pour son œuvre dramatique où
s’exprime une critique sociale exacerbée à
travers des personnages en proie à la violence de l’instinct,
il contribua avec Gœthe à la diffusion de l’œuvre
shakespearienne, dont il retiendra quelques grandes leçons.
Il est, parmi les romantiques, l’individualisme absolu incarné,
le radical. Son caractère asocial, ses échecs sentimentaux
renforceront ses certitudes, son orgueil et, au fil des ans, ce
qui deviendra son délire de persécution, dont Büchner
dans son Lenz a su rendre les progrès.
Figure emblématique de l’inadaptation, il est le
rêve qui, refusant de se plier au réel, sera brisé.
"Nous ignorons si cet homme sensible et déjà
malade eût succombé dans de tout autres conditions
tumultueuses encore plus accidentelles et extérieures de
son existence" (H. Hesse). Certains auteurs allemands actuels
le classent d’ailleurs parmi les précurseurs de 68.
Gœthe, le mondain, comprendra vite qu’il peut nuire
à sa carrière et le rejettera : "Les âneries
de Lenz, hier soir, nous ont fait pâmer de rire. Je n’arrive
pas à m’en remettre".
En proie à la désillusion, déçu, mortifié,
il errera de place en place à travers l’Europe, jusqu’à
ce qu’on le retrouve mort dans une rue de Moscou.
"Quelle étrange composition de génie et d’innocence"
(Wieland).
A
lire :
Le Précepteur
Le Nouveau Menoza
Les soldats
|
Bertolt Brecht est né en 1898 à
Augsbourg, petite ville de Bavière. Après une éducation
classique, il commence à écrire très tôt
et publie son premier texte en 1914 dans un quotidien. Il entame
des études de philosophie à Munich et écrit
en 1918 sa première pièce, Baal, suivie en 1919
de Tambours dans la nuit et en 1921 de Dans la jungle des villes,
trois pièces inspirées du mouvement expressionniste.
Il se marie en 1923 avec Marianne Zoff - il aura tout au long
de sa vie de nombreuses liaisons amoureuses et plusieurs enfants
- et reçoit le prix Kleist pour ses premières pièces,
toutes créées sur scène en 1922-23. Brecht
rencontre l'actrice viennoise Helen Weigel et s'installe avec
elle à Berlin. Il fait la connaissance de Kurt Weill en
1927 et crée avec lui l'Opéra de quat'sous, qui
fut immédiatement un grand succès : le Theater am
Schiffsbauerdamm est désormais à sa disposition.
Marié avec Helene Weigel, il écrit et met en scène
une ou deux pièces par an, dont la Mère, Homme pour
homme, Mahagonny, Happy End, Sainte Jeanne des abattoirs, Têtes
rondes et têtes pointues. Parallèlement à
son adhésion au marxisme, il met au point sa théorie
du théâtre épique qu'il exposera dans son
Petit Organon pour le théâtre publié en 1948.
En février 1933, Brecht et Weigel s'enfuient en Suisse,
puis à Paris, avant de s'installer à Svendborg au
Danemark. En 1935, ils se rendent à Moscou et ensuite à
New York pour la première américaine de la Mère.
Brecht écrit coup sur coup Grand peur et misère
du troisième Reich, la Vie de Galilée et Mère
Courage et ses enfants. Au moment de l'invasion du Danemark, le
couple reprend son errance et se réfugie en Suède,
puis en Finlande, et part finalement pour New York en 1941. La
même année, la création mondiale de Mère
Courage et ses enfants (encore sans les chansons) a lieu à
Zurich, où la Bonne Âme de Se-Tchouan et la Vie de
Galilée seront également créés. Comme
de nombreux écrivains en exil, Brecht s'installe à
Hollywood en 1942 et travaille pour le cinéma (adaptation
cinématographique de Galilée avec Charles Laughton).
Il retourne en Europe en 1947, d'abord à Zurich, puis s'installe
définitivement à Berlin-Est à partir de 1948.
En 1949, Brecht et Weigel obtiennent la nationalité autrichienne.
Le couple fonde le Berliner Ensemble, leur " troupe officielle
", installée au Deutsches Theater. Désormais
autant auteur que metteur en scène de pièces du
répertoire classique, Brecht entreprend la publication
de ses œuvres complètes à partir de 1954, année
où il reçoit le prix Staline. Des tournées
internationales se succèdent, dont celle en France en 1954,
événement décisif pour l'histoire du théâtre
français. Après un voyage à Milan pour assister
à l'Opéra de quat'sous mis en scène par Giorgio
Strehler, Brecht, très malade, meurt le 14 août 1956.
Sa femme continuera de diriger le Berliner Ensemble, fidèle
héritière de son œuvre qui, outre les pièces
de théâtre, comprend également des recueils
de poèmes, des contes, des écrits théoriques
sur le théâtre et des essais.
|
|
Jakob
Lenz Acte II Scène 5 |
Bertolt
Brecht Acte III Scène 10 |
|
A
Heidel brunn
La chambre de Gustine. Gustine est allongée sur
le lit ; Läuffer est assis au chevet.
Läuffer : Figure-toi, Gustine, le conseiller
ne veut pas. Tu vois, ton père me mène la vie
dure, de plus en plus : maintenant, il ne veut plus me donner
que quarante ducats pour l'année prochaine. N'est-ce
pas intolérable ? il va falloir que je donne mon congé.
Gustine : Cruel ! Et moi que ferai-je alors ! (Ils
se regardent en silence pendant un instant). Tu vois : je
suis faible et malade ; ici, dans cette solitude, et livrée
à une mère barbare... Personne ne s'enquiert
de moi, personne ne se préoccupe de moi. Ma famille
toute entière ne peut plus me souffrir, même
mon père : je ne sais pourquoi.
Läuffer : Arrange-toi pour aller en pension chez
mon père, à Insterbourg.
Gustine : Alors, nous ne pourrons plus jamais nous
voir ! Mon oncle ne permettra jamais que mon père me
mette chez ton père.
Läuffer : Ce maudit orgueil d'aristocrate !
Gustine : (lui prenant la main) Toi aussi,
tu te faches, mon petit Hermann chéri ! (Elle lui
baise la main) Mort ! O mort ! Que n'as-tu pitié
de moi ?
Läuffer : Donne-moi même des conseils !...
Ton frère est le garçon le plus insolent que
je connaisse. Récemment, il m'a donné une giffle,
et je ne pouvais la lui rendre, je ne pouvais même pas
me plaindre. Ton père lui aurait rompu les os sur-le-champ
et ta gracieuse mère aurait finalement rejeté
toute la faute sur moi. |
|
| La
chambre de Gustine à Insterburg.
Gustine et Läuffer (au lit)
Läuffer : Et tout cela au départ c'est
la faute de ton père. Avait-il besoin, pour toi,de
faire l'économie d'un précepteur ? Par le même
mouvement de son avarice, il m'a rogné mes appointements.
Maintenant il ne veut plus me donner que cent vingt thalers
pour l'an prochain. Je n'ai plus qu'à m'en aller.
Gustine : Et moi, qu'est-ce que je ferai ?
Läuffer : Tâche de venir chez mon père
; au presbytère d'Ingelshausen.
Gustine : Mon oncle ne permettra jamais que mon père
t'envoie chez ton père.
Läuffer : Cet orgueil des quartiers de noblesse
!
Gustine : (lui prenant la main) Toi ausi tu
deviens méchant, mon petit guerrier ? (elle l'embrasse)
O mon maître, comment trouves-tu ton élève
? Pâle comme la mort ?
Läuffer : Fraîche comme un goujon. Donne-moi
plutôt un conseil. Hier, Monsieur ton frère m'a
encore gifflé.
Gustine : Supporte-le pour moi.
Läuffer : Et je me ferais des reproches pour ne
pas m'être dominé ? En vérité,
on me gave trop richement pour un esclave : céleri,
dinde, chocolat... Un corps ainsi dorloté, on veut
qu'il ne péche point ? |
|
|